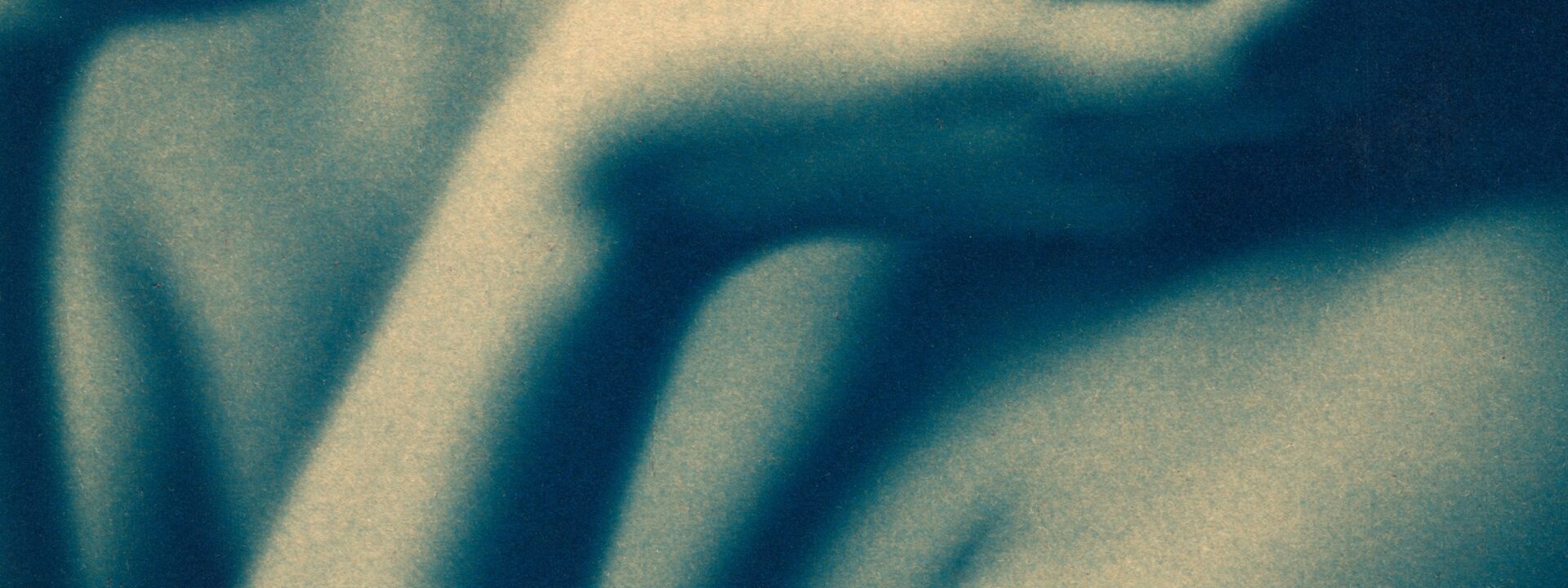J’avais seize ans quand j’ai appris pour la première fois à faire semblant, et l’alcool fut mon professeur. C’était en 2002, ma dernière année de lycée, et j’étais la plus jeune de mon groupe d’amis—plus un fardeau qu’un motif de fierté. J’avais commencé la maternelle tôt, sauté une partie du CP, et passé mon adolescence à essayer de suivre des amis et camarades de classe toujours plus âgés d’un an ou deux.
Cette nuit-là ne fut pas différente. J’étais dans la maison au bord du lac d’une amie à Conroe, au Texas, pour une soirée pyjama. Je n’avais pas tout dit à mes parents—que c’était mixte, que ses parents n’étaient pas là, et qu’il y aurait de l’alcool. J’ai pris ma première gorgée entourée de rires et de cette confiance téméraire propre aux adolescents privilégiés et protégés des banlieues texanes—des jeunes qui ne comprenaient pas vraiment les risques ni où cette première gorgée pouvait mener.
Ma première pensée fut : je n’aime pas ça. C’était amer. Ça piquait ma langue et brûlait ma gorge. J’ai fait la grimace. Mais en regardant autour de moi, tout le monde souriait, le visage radieux, feignant d’être leur moi le plus heureux—ou déjà ivres après une seule gorgée. Personne n’a mentionné le goût, et je n’ai rien osé dire. Alors j’ai souri moi aussi, imitant leur joie, et je l’ai avalé. Je n’aime pas ce qui est amer, mais j’ai fait comme les autres. J’ai fait semblant. Ma première gueule de bois m’a anéantie pendant des jours—martèlement dans la tête, estomac barbouillé.
La semaine suivante, en cours d’anglais avancé, nous avons commencé à lire des tragédies grecques. J’ai été attirée par *Les Grenouilles* d’Aristophane. Alors que Dionysos descendait aux enfers, je me suis sentie comme faisant partie du chœur—planant en arrière-plan, hésitante, réticente à dire la vérité.
Je n’ai plus bu avant le début de la vingtaine, quand l’alcool a commencé à avoir de réels bénéfices sociaux, souvent positifs. Il y eut des brunchs, des happy hours, des dîners professionnels, des célébrations. Un verre ici, une bouteille là, un shot de temps en temps. Le livre de G.M. Shepherd *Neurogastronomie* (2012) explique comment le cerveau traite le goût et comment une exposition répétée peut nous faire aimer ce que nous détestions, surtout sous influence sociale et culturelle.
Mes amis plaisantaient en disant que je « baby-sittais » mes cocktails—sirotant lentement des boissons fruitées ou crémeuses lors de nos rendez-vous en ville. La vérité est que, alors comme maintenant, je n’ai jamais aimé le goût de l’alcool. En tant que personne née au Liberia et élevée au Texas, mes goûts penchent vers l’hyper-féminin : j’aime les choses belles, symétriques, douces et sucrées. Pourtant, toutes mes relations sérieuses dans la vingtaine, y compris avec l’homme que j’allais épouser, étaient avec des personnes qui aimaient parler de vieux scotch et de plantations de tequila de luxe à Sag Harbor ou Milan. À cette époque, ce que vous buviez disait beaucoup sur votre expérience du voyage, votre lieu de vie, et parfois la durée potentielle d’une conversation.
Alors j’ai joué le jeu. J’ai appris à apprécier l’Opus One. J’ai appris quels millésimes et assemblages je préférais. Je me demande souvent combien d’autres dans ces pièces étaient comme moi—supportant l’amertume pour un avant-goût de liberté face à la gêne et l’anxiété. Pour la tranquillité d’esprit. Pour le pouvoir d’oublier.
En 2024, j’avais eu trois enfants en trois ans : une fille début 2021, un garçon en 2022, et un autre garçon exactement un an plus tard—une grossesse surprise découverte à quinze semaines. Après avoir passé ma vingtaine à voyager, écrire et profiter de tout ce que Brooklyn avait à offrir, des membres plus âgés de ma famille—traditionalistes libériens, baby-boomers mariés depuis longtemps—m’ont dit qu’il était temps de me poser. Alors je l’ai fait. J’ai eu les enfants. Et alors que je commençais à prendre du retard dans ma carrière littéraire (j’avais presque quatre ans de retard sur mon délai… Avec le délai de mon deuxième roman repoussé par l’arrivée de mon troisième bébé, je me sentais coupable de ne pas ressentir une joie pure—surtout puisque ma première grossesse, en 2019, s’était terminée par une fausse couche. Alors chaque fois qu’on me questionnait sur les enfants, mon mari, notre duplex à Upper West Side, ou la vie que j’avais tant travaillé à construire, je prenais une gorgée de vin et disais que tout était merveilleux. Je souriais, même en avouant des nuits blanches et l’épuisement mental. Oui, il y avait de la joie—mais elle était mêlée à d’autres sentiments dont personne ne m’avait avertie. J’étais anxieuse. J’avais peur. La personne que j’étais me manquait.
La maternité, comme la consommation sociale d’alcool, avait ses propres règles non-dites. C’était comme traverser les moments difficiles pour atteindre un avenir radieux—des enfants réussis, éduqués et mariés, contribuant au monde, pleins d’espoir et de gratitude, me donnant peut-être même des petits-enfants un jour. On attendait de moi que je sourie through la fatigue, que je cache mon anxiété alors que mon corps et mon esprit étaient encore en healing.
Heureusement, tout a atteint un point de rupture.
Mon mari a loué une maison d’été à Southampton pour notre famille, et nous avions des amis qui restaient pour le weekend. Ce premier soir, le dîner a commencé par une conversation légère mais est rapidement devenu tendu. Des étrangers utilisaient des verres de vin coûteux pour alimenter des disputes politiques et masquer leur malaise. J’ai bu plus que jamais. Le lendemain matin, une nouvelle amie m’a prise à part pour une promenade.
Elle m’a dit que j’avais dit des choses sur des membres de ma famille—des choses que je ne pouvais même pas imaginer penser, encore moins dire—et elle voulait prendre de mes nouvelles. Elle ne les avait pas entendues elle-même ; un autre invité, que je connaissais à peine, le lui avait dit. Je n’avais aucune défense, aucun souvenir, aucun contrôle. Je me suis sentie complètement impuissante. Que s’était-il passé ? Était-ce l’alcool ? Les hormones post-partum ? Ou juste le poids de tout ça ? J’ai déprimé. Pouvez-vous imaginer ? Plus tard dans la journée, j’ai pleuré en jouant avec les enfants à l’étage. Tout ça, et je n’aimais même pas le goût de l’alcool. Je n’ai plus bu depuis.
Une année de sobriété m’a apporté une clarté sur toutes les petites façons dont j’avais fait semblant, et où tout cela avait commencé. D’abord, j’ai été honnête sur mon écriture. Personne n’allait me sauver. Si je voulais finir mon roman, je devais me pousser—non pas en me concentrant sur le livre terminé, mais en commençant par le premier mot. Si je voulais me retrouver, j’avais besoin de thérapie et de guidance pour comprendre ce nouveau rôle—mère—qui semblait éclipser tout le reste. Si je voulais me sentir en sécurité, je devais être plus prudente sur qui je laissais entrer dans ma vie, mais je devais aussi me regarder honnêtement. Comment avais-je fait taire ma propre voix au fil des années ? Combien de fois avais-je ri quand je voulais pleurer ou crier ? Ces premières leçons de retenue—pour m’intégrer, éviter les conflits, garder les choses fluides—ont eu des effets durables.
Jusqu’à récemment, on entendait rarement parler de la difficulté de la grossesse, de la durée de la récupération, ou de l’ajustement émotionnel profond que demande la maternité. Il y a tellement de joie, mais certains jours sont incroyablement—et parfois déraisonnablement—durs.
Je veux apprendre à mes enfants qu’aucune approbation des autres—ni des pièces qu’ils occupent, des tables où ils s’assoient, des cercles qu’ils fréquentent, des emplois qu’ils ont, des mariages qu’ils construisent, ou des amitiés qu’ils forment—ne sera jamais plus puissante que d’apprendre à s’affirmer eux-mêmes, vraiment et complètement. Je veux qu’ils sachent que le bonheur et la tristesse peuvent coexister, que les deux sont valides et connectés. Faire semblant m’a appris à survivre, mais m’a aussi montré ce que je ne veux plus porter. Je veux que mes enfants voient que la beauté de la vie réside dans les moments bruts, non filtrés—vivre pleinement, sans craindre les vérités inconfortables. Vivre pleinement, et rendre ça doux.
Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQs sur la façon dont la maternité transforme la perception de soi et la relation avec l'alcool, avec des réponses claires et concises.
Questions Générales Débutant
1 En quoi devenir mère change-t-il la perception de soi ?
Devenir mère transforme souvent l'identité d'individu à celle de pourvoyeur de soins. Vos priorités, valeurs et gestion du temps changent fondamentalement, ce qui peut mener à une redécouverte de qui vous êtes.
2 Pourquoi la maternité pousse-t-elle souvent à reconsidérer sa consommation d'alcool ?
La responsabilité de s'occuper d'un enfant exige d'être alerte et présente 24/7. Beaucoup de mères constatent que boire entre en conflit avec ce besoin, les amenant à questionner le rôle de l'alcool dans leur vie.
3 Est-il courant de moins boire après avoir eu un bébé ?
Oui, c'est très courant. Les exigences parentales comme les biberons de nuit et les lever tôt rendent naturellement l'alcool moins attrayant ou pratique pour beaucoup.
4 Que signifie la « Mommy Wine Culture » ?
C'est une tendance populaire qui normalise et même plaisante sur le besoin des mères de boire du vin pour gérer le stress parental. Elle présente souvent l'alcool comme une récompense ou un soulagement nécessaire.
Questions Approfondies Avancées
5 La maternité peut-elle mener à une dépendance malsaine à l'alcool ?
Malheureusement, oui. L'immense pression et l'isolement de la nouvelle maternité, combinés au message « wine mom », peuvent parfois conduire à utiliser l'alcool comme mécanisme principal d'adaptation, ce qui peut être risqué.
6 Comment changer mes habitudes de consommation peut-il améliorer mon expérience de la maternité ?
Boire moins peut mener à plus de patience, un meilleur sommeil, plus d'énergie et une présence mentale et émotionnelle complète pour vos enfants. Cela permet de vivre les moments bruts et non filtrés de la parentalité.
7 Je me sens coupable de ne pas profiter de chaque moment. Est-ce que boire aidera ?
Cela pourrait offrir une échappatoire temporaire, mais cela ne traite pas les sentiments racines. Vraiment s'adapter vient souvent en trouvant du soutien, en gérant les attentes et en pratiquant des soins personnels sans alcool.
8 Quels sont certains signes que ma consommation pourrait être problématique ?
Les signes incluent : organiser votre journée autour de la boisson, avoir besoin d'alcool pour se détendre ou s'amuser, se sentir coupable sur sa consommation, ou être incapable de s'arrêter après un verre.
Conseils Pratiques Soutien
9 Quelles sont des alternatives sans alcool pour se détendre après une longue journée avec les enfants ?
D'excellentes alternatives incluent une tasse de tisane, une promenade à l'extérieur, quelques minutes