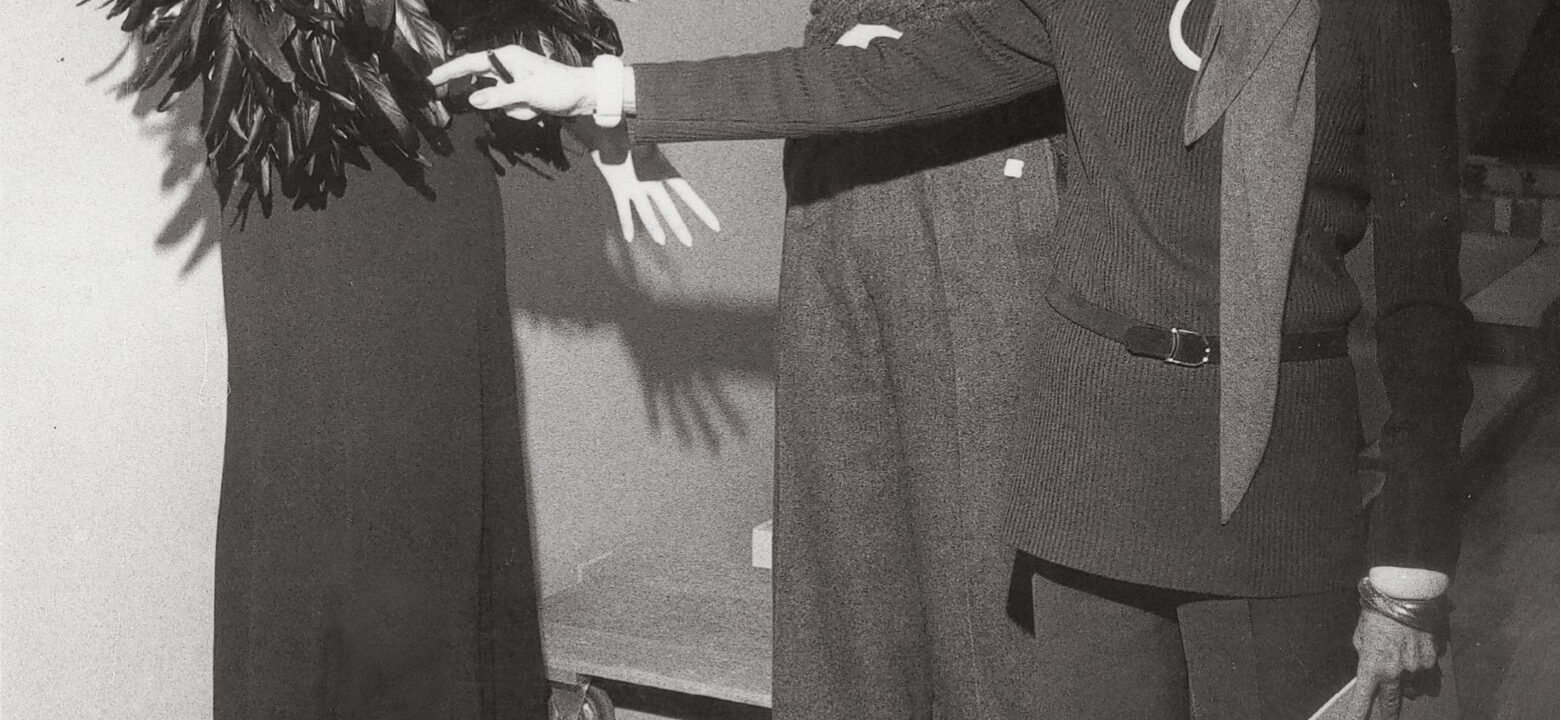**"Regarde vers l'ange du foyer" par André Leon Talley** a été publié pour la première fois dans le numéro de mars 2003 de **Vogue**. Pour plus de moments forts des archives de **Vogue**, inscrivez-vous à notre newsletter Nostalgie [ici](lien).
Si je vous dis que j’écris sur le luxe, vous pourriez supposer que je vais partager des leçons de Diana Vreeland, cette reine autoproclamée de l’extravagance. Ou peut-être que je vais me remémorer l’âge d’or de l’indulgence dans la mode. Ou encore que je vais m’extasier sur le savoir-faire impeccable d’une chaussure sur mesure. Et vous n’auriez pas tout à fait tort.
Mais ce n’est pas de ce luxe-là dont je parle.
La vérité, c’est que je vis à grande échelle — parce que la mode l’exige. Elle est démesurée, imprévisible, éblouissante. Pourtant, elle ne fournit pas les bases dont une personne a besoin pour mener une vie équilibrée et épanouissante — une vie qui ne sert pas seulement soi-même, mais aussi les autres. La mode ne peut pas remplacer la famille, et je doute que j’aurais jamais apprécié la haute couture si je n’avais pas d’abord appris à valoriser des choses plus simples.
Bien avant de devenir l’assistant de Mme Vreeland au Costume Institute du Met, bien avant mes rôles à **WWD**, **W** ou **Vogue**, j’étais un petit garçon noir élevé par ma grand-mère travailleuse en Caroline du Nord.
En grandissant, j’ai appris à vivre simplement en observant ma grand-mère, Bennie Frances Davis. Elle travaillait, priait et a construit un foyer pour moi. Sa vie n’était pas facile, mais elle était guidée par des principes clairs et inébranlables — l’église et la famille, indissociables et centraux. Sa maison était impeccable, chaleureuse et accueillante, un lieu où l’amour et le soin étaient aussi visibles que l’éclat de chaque surface.
C’était le luxe que je connaissais : non pas l’excès, mais la beauté des tâches ordinaires bien faites, des choses simples chéries et entretenues. La foi, l’espérance, la charité — et oui, le luxe, parce que chez nous, il était sacré.
En 1989, j’avais 40 ans, surnommé "Monsieur Vogue", prospère dans ma carrière. Mais cette année-là, j’ai perdu les deux femmes qui m’ont façonné : ma grand-mère et Diana Vreeland. Toutes deux avaient combattu la maladie avec acharnement, et leurs décès m’ont brisé le cœur.
Ma grand-mère avait élevé quatre enfants (en perdant deux à la naissance), travaillé comme femme de ménage, et après son veuvage, m’avait recueilli. Elle nettoyait les chambres d’étudiants à l’université Duke cinq jours par semaine. Notre maison était remplie d’amour et de meubles récupérés des étudiants.
Diana Vreeland aussi maintenait une maison immaculée — bien que la sienne soit entretenue par une petite armée de domestiques. Ma grand-mère faisait tout elle-même : la cuisine, la lessive, s’occuper de la famille. Deux ans avant son décès, on lui a diagnostiqué une leucémie, mais elle a caché sa douleur, comme elle l’avait toujours fait — discrètement, avec dignité.
C’est le luxe dont je me souviens. Non pas l’extravagance, mais l’amour, la discipline et la force tranquille d’une vie bien vécue. Elle avait caché sa maladie à ses proches, et je n’ai découvert son état qu’un dimanche où je me suis précipité en Caroline du Nord. Elle était là, dans un fauteuil roulant aux urgences de l’hôpital universitaire Duke, enveloppée dans sa robe de chambre, entourée de ses nièces préférées. C’est alors que j’ai appris qu’elle se rendait secrètement depuis des mois au cabinet du Dr Cox pour une chimiothérapie orale. J’ai passé cette nuit interminable sur un lit d’hôpital à côté du sien dans la salle des urgences, la regardant dormir et priant pour un miracle.
Après une vie de labeur, apprendre à se reposer ne vient pas facilement. Ma grand-mère et Diana Vreeland ont toutes deux fait face à la maladie avec une dignité remarquable, refusant de la laisser les définir. Ma grand-mère a continué à cuisiner, à faire la pâtisserie et des tâches ménagères légères jusqu’à la fin. Mme Vreeland — comme je l’appelais toujours — s’est retirée dans son lit derrière ces élégantes portes laquées rouges, où je m’asseyais pour lui faire la lecture tandis qu’elle reposait, parfaitement habillée sur les couvertures, ses orteils et ongles peints de son rouge signature.
Maman (ma grand-mère) ne portait jamais de vernis rouge — son seul maquillage était un rouge à lèvres du dimanche pour l’église. Deux jours avant sa mort, elle s’est encore traînée avec son déambulateur pour me border alors que je faisais une sieste sur la chaise longue de sa chambre. Pour ses 90 ans, je lui ai organisé une fête surprise où elle portait un tailleur bleu marine de Calvin Klein et m’a laissé épingler un gros corsage à son revers alors qu’elle se tenait devant son gâteau à étages.
J’ai rencontré Mme Vreeland pour la première fois lors de mon tout premier jour au Met en 1974, quelques années après avoir obtenu mon master à Brown. Arrivé tôt dans mon trésor de lycée — un pull en laine mérinos jaune citron à col en V que Maman m’avait acheté — associé à un pantalon en alpaga bleu marine comme ceux que je portais à l’église, j’étais l’image même de la bienséance. Je n’avais pas encore découvert le cachemire six fils.
La conservatrice du Costume Institute, Stella Blum, m’a immédiatement tendu une boîte à chaussures étonnamment lourde, des gants en coton blanc et une pince à bec effilé. En l’ouvrant, j’ai découvert un enchevêtrement de disques métalliques violacés. "C’est la robe en mailles de chaîne de Lana Turner dans **The Prodigal**", m’a-t-elle expliqué quand j’ai demandé. Ma tâche ? La reconstituer sur un mannequin avant l’inspection de Mme Vreeland.
Démêler la robe a pris un temps considérable — c’était une jupe frangée de style Charleston attachée à un soutien-gorge et un bikini. De nombreux fils de connexion étaient endommagés après des années de stockage, et ma maladresse avec les pinces industrielles me faisait craindre d’abîmer les pièces délicates. Mais je suis resté calme, déterminé à résoudre le problème qu’on m’avait confié.
Après une étude attentive, j’ai réalisé que la restauration ne serait pas aussi difficile que je le craignais. À l’heure du déjeuner, je faisais des progrès satisfaisants — juste au moment où Mme Vreeland a fait son entrée. L’ayant idolâtrée à travers **Vogue** depuis l’enfance, j’ai soudain craint de rencontrer cette légende qui allait juger mon travail, sentant que ce moment avait une importance plus grande que je ne pouvais encore le comprendre. D’une certaine manière, je sentais que mon avenir dépendait de son jugement. J’ai essayé de rester hors de vue, feignant de travailler derrière une colonne tout en la surveillant du coin de l’œil. Elle marchait avec des pas rapides et délicats sur la pointe des pieds — elle ne supportait pas le bruit des talons claquant contre le sol. La pièce était si silencieuse qu’on aurait pu entendre une épingle tomber tandis qu’elle glissait avec la grâce d’une danseuse. Même un jour ordinaire, elle se tenait comme une reine. Elle savait comment faire une entrée.
La première chose que j’ai remarquée, c’était son caban bleu marine de Saint Laurent, puis son pantalon en jersey double face Mila Schön et ses bottes en python rouge vif Roger Vivier, cirées à l’éclat du vernis.
Elle était pleinement elle-même. Cette fameuse démarche — bassin en avant — était réelle. Sa silhouette fine comme une feuille, réelle. Son maquillage dramatique (qu’elle appelait "Kabuki"), absolument réel. Elle portait du rouge à joues étalé avec de la Vaseline sur ses tempes, exagéré jusqu’au théâtral. Pas de salutations, pas de bavardages — mais en passant devant le mannequin portant ma création inspirée de Lana Turner, elle s’est arrêtée et a tonné : "Qui a fait ça ?" Je ne savais pas si elle était ravie ou horrifiée. Quelqu’un a répondu : "Le nouveau bénévole, Mme Vreeland."
Elle a continué son chemin, et j’ai pensé : **Elle déteste ça.** Trois minutes plus tard, après s’être installée à son bureau et avoir enlevé son manteau, une assistante m’a dit que Mme Vreeland voulait me voir. Cette convocation pouvait tout signifier — j’espérais que c’était bon. Quelque chose s’était passé dans ce bref instant où elle avait passé devant mon travail, bien que je ne sache toujours pas exactement quoi.
Quand je suis entré dans son bureau, elle prenait son déjeuner habituel : un petit verre de Dewar’s White Label et un sandwich fin de chez Poll’s, sur Lexington Avenue. "Assieds-toi", a-t-elle dit sèchement. Son expression m’a indiqué qu’elle aimait ce que j’avais fait.
Elle a sorti un bloc-notes jaune et un crayon bien taillé, se penchant légèrement vers l’avant. Une dent de tigre pendait à une chaîne en or autour de son cou. "Alors, comment t’appelles-tu, jeune homme ?" a-t-elle tonné, redressant sa posture déjà rigide. Sa voix, puissante pour une si petite silhouette, m’a rappelé ma grand-mère m’appelant pour dîner. "André", ai-je dit.
Elle a commencé à écrire d’une écriture large et énergique — si grande que je pouvais la lire à l’envers. À côté de mon nom, elle a écrit : **L’Aide.**
"Maintenant", a-t-elle dit en posant le crayon, "tu resteras à mes côtés jour et nuit jusqu’à ce que l’exposition soit terminée ! Allez, mon petit. Retour à la galerie. En avant !"
J’étais stupéfait par le nombre d’accessoires que possédait Mme Vreeland — bien que pas surpris par l’importance qu’elle leur accordait. Ma grand-mère m’avait appris à apprécier les détails fins : la chaussure parfaite, le chapeau qui encadrait un visage à merveille, les petites touches qui rendaient une tenue extraordinaire. En grandissant, c’était une tradition chez nous de chérir les belles choses — comme les gants en chevreau glacé et les bonnes chaussures en cuir réservées au dimanche, ainsi que les sous-vêtements spéciaux et les corsets lacés de ma grand-mère, qui semblaient tout droit sortis des Années Folles quand ils séchaient sur la commode.
Je ne sais pas comment Maman avait réussi à accumuler autant de gants fins, mais elle l’avait fait, en les budgétant soigneusement. Bien qu’elle n’ait jamais pensé à quelqu’un comme la duchesse de Windsor, elles partageaient une habitude : ne jamais sortir sans une paire de rechange dans son sac, au cas où.
Peu avant la mort de Maman, j’ai trouvé une réserve de gants vintage Dior des années 1950 jamais portés à Paris et je les lui ai rapportés. Elle a été enterrée avec une paire, et bien sûr, j’en ai glissé une neuve dans son cercueil — au cas où. Je lui ai aussi donné un éventail d’église avec une image du révérend Martin Luther King Jr., une boîte de son tabac à priser préféré et quelques mouchoirs supplémentaires — au cas où ceux qu’elle portait se saliraient. Pour ses funérailles par ce froid jour de mars, j’ai choisi l’hymne "No Tears in Heaven", un souvenir qui me reste toujours. J’étais heureux de l’avoir accompagnée avec les bonnes choses, sachant combien elle serait fière d’entrer au paradis avec ces gants Christian Dior, bien ajustés juste en dessous des coudes.
Ma grand-mère et Mme Vreeland ont été les personnes les plus importantes de ma vie, et leur sagesse me guide encore dans tout ce que je fais. Bien qu’elles soient parties, je les sens toujours avec moi — comme deux anges gardiens, un sur chaque épaule. Je leur parle souvent, dans le langage silencieux de la mémoire.
Au final, ce qui compte le plus pour moi, ce n’est pas le glamour et les paillettes du monde dans lequel j’évolue aujourd’hui, mais mes racines profondément sudistes. Les livres de mode peuvent regorger de ragots croustillants, mais ce n’est pas ce qui compte vraiment. Ce qui importe, c’est de savoir d’où l’on vient et qui l’on est.
L’amour et la protection de ces deux femmes me guident encore dans la vie. L’amour inconditionnel qui a quitté ce monde en 1989 me fait avancer, même dans les moments les plus difficiles, avec des murmures de gratitude.
Quand la vue de Mme Vreeland a commencé à faiblir en 1986, elle s’est alitée — la même année où elle a manqué le gala d’ouverture du Met pour une exposition sur les costumes indiens, un spectacle qu’elle aurait adoré. Ce soir-là, je suis allé avec Carrie Donovan à la place. C’était une nuit éblouissante, un hommage au génie de Mme Vreeland, mais son absence planait sur tout. Diana Vreeland n’était jamais en retard, encore moins absente d’une fête censée la célébrer.
Le lendemain matin, je l’ai appelée immédiatement. Dolores, sa secrétaire, lui a passé le téléphone aussitôt.
"André, viens dîner ce soir", a-t-elle dit sans même un bonjour, sa voix aussi vive que jamais. "Je veux tout savoir sur hier soir."
Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle n’était pas venue dans sa nouvelle tenue rose d’Yves Saint Laurent. J’ai simplement accepté et raccroché, toujours intrigué. Ce soir de décembre morose a été la première fois où j’ai vu Mme Vreeland alitée.
Son explication était simple. "André, j’ai eu une vie merveilleuse, et maintenant j’ai décidé de prendre les choses calmement. Regarde tous les designers que j’ai aidés — Oscar, Bill, Halston. J’en ai assez fait. Maintenant, je vais me détendre et profiter de la vie. Tout simplement, j’en ai assez !" Comme Miss Havisham — mais sans la poussière —, elle s’est retirée dans sa chambre.
Quand elle m’a dit cela, j’ai pensé à ma grand-mère et moi regardant les funérailles du Dr King sur notre vieille télévision noir et blanc. Alors qu’un soliste chantait, **Si je peux aider quelqu’un, alors ma vie n’aura pas été vaine**, Maman s’est tournée vers moi et a dit : "C’est la devise que nous devons suivre." Bien que venant de mondes différents, elle et Mme Vreeland partageaient le même but : aider les autres. Et parce qu’elles l’ont fait, leurs vies n’ont pas été vaines.
Ces deux femmes ont gardé leur dignité, même dans leur vieillesse. Mme Vreeland était aussi soignée dans son lit qu’elle l’avait été à **Vogue**, et quand ma grand-mère a pris sa retraite, je lui avais offert plus de tailleurs Chanel et de sacs Gu