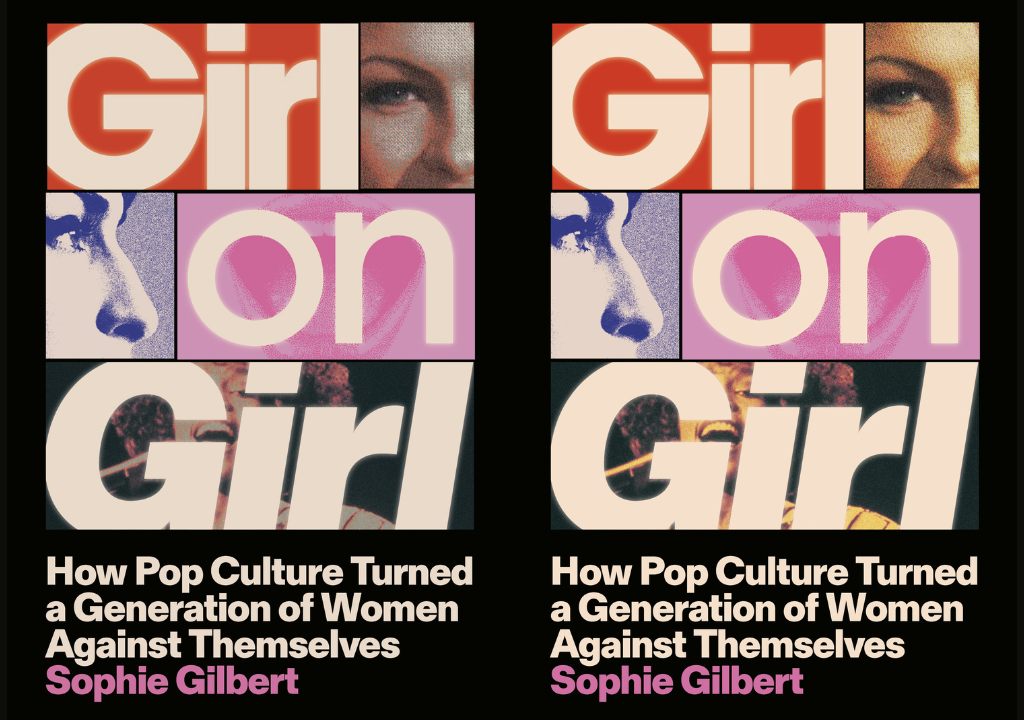Sophie Gilbert, journaliste au sein de The Atlantic, s’est fait un nom en couvrant la culture pop – de Madonna et Taylor Swift à The White Lotus et Severance – tout en étant finaliste du prix Pulitzer pour ses critiques. Elle est devenue une sorte de critique culturelle moderne à l’ère du TikTok.
Son nouveau livre, Girl on Girl : Comment la culture pop a monté une génération de femmes contre elles-mêmes (sortie le 29 avril chez Penguin Press), revisite la fin des années 1990 et le début des années 2000, examinant ce qu’il est advenu du féminisme au début du XXIe siècle. Elle y explore comment la culture pop a croisé les questions de sexe, de politique, de célébrité et de moralité au cours des dernières décennies.
Ici, Gilbert parle de culture, de célébrité et d’espoir en des temps difficiles.
Vogue : Qu’est-ce qui a inspiré ce livre ?
Sophie Gilbert : Deux moments m’ont particulièrement marquée. D’abord, j’ai accouché de jumeaux en juillet 2020 à New York, en plein COVID. Les mois suivants, je me suis complètement perdue. Je ne pouvais ni lire ni regarder la télé, je dormais à peine et étais trop épuisée pour manger. Mon mari et moi nous occupions de ces tout-petits bébés dans un isolement total, ce qui a provoqué une sorte d’effondrement personnel. Quand j’ai enfin repris le travail et renoué avec le monde, je revenais sans cesse à des histoires sur la culture et l’identité – comment l’art que nous consommons nous façonne, pour le meilleur ou pour le pire.
Le deuxième moment a été l’annulation de Roe v. Wade en 2022. Je ne comprenais pas comment les femmes – majoritaires en Amérique – pouvaient avoir si peu de pouvoir. La seule explication à laquelle je pensais était que la culture pop nous avait endormies dans la passivité et la distraction.
Vogue : Vous terminez votre introduction sur une note optimiste : “Nous essayons de comprendre comment les choses ont dérapé pour imaginer une voie plus puissante vers l’avant.” Croyez-vous vraiment que ce soit possible ?
Gilbert : Nous traversons une période de profonde agitation, et ce qui arrive aux personnes trans, aux immigrés, aux réfugiés et aux femmes sous cette administration est terrifiant. Mais dans l’ensemble, la culture que nous consommons ne renforce pas ces attaques – elle y résiste.
Vogue : Vous écrivez que les femmes dans la musique des années 1990 étaient “en colère, abrasives et incroyablement puissantes”, avant d’être remplacées par des “filles”. Sommes-nous toujours dans ce cycle ?
Gilbert : Aujourd’hui, tant d’artistes femmes refusent de se limiter, même quand elles sont critiquées pour cela. Sabrina Carpenter est attaquée pour être sexy sur scène – comme si cela n’avait pas toujours fait partie de sa musique depuis qu’elle est adulte. Chappell Roan est totalement sans filtre en interview, explorant la sexualité sans se plier aux attentes masculines. Doechii essuie des critiques juste pour exprimer ses préférences amoureuses. Ces femmes sont souvent critiquées pour leur honnêteté, mais elles ne reculent pas – elles remportent des prix et font le plein en concert. Et elles ne rendent de comptes à aucun homme dans un bureau. Ça ressemble à du progrès.
Vogue : Vous explorez la tension entre “filles” et “femmes” – l’adolescence face à l’expérience vécue. Qui représente bien cette distinction ?
Gilbert : Pour l’adolescence féminine, il y a tant de portraits brillants. Girlhood (2021) de Melissa Febos est ma référence – elle capture à quel point grandir peut être traître. J’adore Pen15, Lady Bird de Greta Gerwig et Chewing Gum de Michaela Coel. Euphoria m’a perturbée – il y a quelque chose de voyeuriste, même si la série tente de montrer la toxicité de l’adolescence. Nous avons transmis beaucoup de choses à la Gen Z. Je crois que les adolescentes d’aujourd’hui sont bien plus conscientes et ont accès à des influences variées, ainsi qu’au vocabulaire pour reconnaître et dénoncer la misogynie. Mais elles subissent aussi des attaques constantes sur les réseaux sociaux, ce que nous n’avons jamais connu.
Pourquoi tant de films des années 2000 – comme Shallow Hal, Knocked Up, White Chicks et Bringing Down the House – étaient-ils si violemment anti-femmes ? Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
À l’époque, les films grand public ne voulaient montrer les femmes que comme des faire-valoir stupides ou agaçantes pour des héros masculins maladroits. Mais récemment, nous avons vu tant d’histoires captivantes sur le vieillissement, les standards de beauté, le désir, le deuil, la maternité ou la performance de la féminité et du pouvoir. Ce n’est pas pour dire que l’industrie est parfaite maintenant, mais elle a progressé.
Vous avez écrit : “Les femmes que notre culture prétend le plus détester sont souvent celles que nous ne pouvons pas ignorer.” Pouvez-vous expliquer ?
Je couvre Kim Kardashian depuis mes débuts à The Atlantic il y a plus de dix ans. Au début, chaque article sur elle déclenchait des commentaires outrés m’accusant de dégrader le magazine en m’intéressant à cette “poubelle”. Mais aujourd’hui, Kim est sans doute la femme la plus influente au monde – et elle y est arrivée en comprenant intuitivement ce que les gens voulaient voir d’elle. Nous avons toujours détesté les femmes qui captent notre attention : Anna Nicole Smith, Britney Spears, Paris Hilton, Madonna. Je pense qu’une partie de cette colère vient de notre frustration à être autant attirés par elles. Des hommes comme Kanye West ou Elon Musk provoquent aussi des réactions, mais ils ne subissent pas le même mépris – cette idée qu’ils ne méritent même pas qu’on en parle.
Il est impossible d’évoquer la représentation des femmes sans considérer l’influence omniprésente des célébrités. Comment cela a-t-il évolué ?
C’était l’un des aspects les plus fascinants de mes recherches – comment la culture des célébrités a changé dans les années 2000 et ce que cela a signifié pour nous. Au XXe siècle, on pouvait devenir célèbre dans les tabloïds sans réel talent. Mais au XXIe, avec les magazines people et Internet avides de contenu, les femmes prêtes à être photographiées, à fréquenter les bonnes soirées ou à ouvrir leur vie aux caméras pouvaient devenir célèbres rien qu’en étant vues. La visibilité est devenue un métier. Ce qui a changé alors – et persiste aujourd’hui –, c’est l’illusion que n’importe qui peut être célèbre en jouant le jeu. La vraie question est : à quel prix ?
Cet entretien a été édité et condensé.
Girl on Girl : Comment la culture pop a monté une génération de femmes contre elles-mêmes
28 $ BOOKSHOP